Voir la bande annonce de Dracula untold, c’était déjà sourire au coin des lèvres. On flairait à 100 lieues le plaisir coupable. A l’arrivée en salle, un « Suce moi goulument ! » balancé par une bande de collégiens sécheurs de cours dissuadait de toute prise au sérieux de l’objet. Et pourtant, malgré ses atours de seigneur des anneaux mal fagoté, Dracula untold en a à revendre, insufflant quelques variations à la légende que nous connaissons tous.
L’histoire : Transylvanie. L’armée turc déferle, et fait capituler le pays sans résistance. Pour étancher sa soif, elle réclame un tribut de mille enfants, donc le prince héritier. Dressé au combat, le jeune prince Vlad se distingue par sa cruauté, réussissant à racheter sa liberté par les victoires offertes aux Turcs. Mais alors qu’il reprend les reines de son royaume, l’armée turque réclame un nouveau tribut…
Avouez que ça en jette ! On croyait, vu la bande annonce, que le film allait durer 20 minutes, et découvrir une certaine richesse scénaristique de ce calibre, ça fait ma foi plaisir. En fait, ce Dracula untold est, à son échelle, une bonne petite surprise. En grande partie pour la discrétion dont il a été l’objet (il n’a été annoncé qu’un mois avant sa sortie), et pour ses modestes ambitions. En effet, la comparaison avec le Dracula de Coppola est inévitable, et le réalisateur semble en avoir conscience (rien qu’à l’apparition du titre, on sent l’hommage). Mais il prend vite ses distances, aussi bien dans l’esthétique que dans les pistes du scénario qu’il développe. Alors que l’armée turque menace la Transylvanie d’une nouvelle invasion, Vlad prend conscience de la présence d’une entité démoniaque rôdant sur ses terres. Mais la réclamation du tribut change la donne. Sa lignée est menacée et son peuple refuse de se soumettre à la requête. Le prince, pourtant soucieux de privilégier la diplomatie (par de régulières offrandes d’argent), se voit obligé de faire face sans armée régulière. Rien de tel qu’une bonne malédiction pour changer la donne. Et c’est là que Dracula untold donne enfin ce qu’il a dans le ventre. Il n’hésite à recourir à de purs artifices bisseux (vision thermique, yeux rouges, combats surdécoupés ou ralentis…) qu’il tente d’allier à un souffle de tragédie fantastique à l’ancienne. Un pur objet de divertissement respectueux de ses racines, mais soucieux de son efficacité. Pour être crédible dans l’héroïc fantasy, il repompe une partie de son esthétique et de sa mécanique sur le seigneur des anneaux. On le voyait déjà dans la bande annonce, alors autant l’encaisser d’office. Ca n’alourdit pas, au contraire. De beaux paysages gothiques, de splendides scènes d’exodes, des batailles rangées de turcs aux yeux bandés pour ne pas voir le monstre qu’ils affrontent (symbolique lourde sur le fanatisme, mais assumée avec un sérieux qui fait passer la chose)… Dracula untold en a à montrer (belle photographie, qui essaye à plusieurs reprises de rendre justice aux décors). Tout comme la découverte du vampire, excellente scène à l’intensité dramatique palpable, et dont le symbolisme humble touche à son but. Malheureusement, Dracula a aussi des côtés sombres. Notamment sur l’exploitation de ses bonnes idées. Ce film a d’évidentes ambitions visuelles. Curieusement, contrairement à nos attentes (la découverte des pouvoirs en accéléré, on ne perd pas de temps), Dracula ne fait pas vraiment de scènes de combo de jeux vidéos dignes d’un Matrix Reloaded. C’est pourtant ce qu’il doit montrer, notamment au cours de la nuit de transformation de Vlad, qui balaie une centaine d’hommes à lui tout seul. Alors le film tente un travelling tournant autour d’une lame, sur laquelle se reflètent des bribes du carnage. Bonne idée visuelle, le résultat est pathétique, on ne voit rien du tout. Et sur de nombreuses idées, intellectuellement bonnes, le résultat se trouve être piteux. La séquence de chute d’Elisabeth, pensée pour avoir l’intensité de celle de Amazing Spiderman 2 (oui, triste comparaison), en devient gênante de par son insistance sur le numérique de ses effets. Le combat contre le général turc et son piège, excellente idée, mais visuellement, résultat inégal, et le jeu des acteurs, pathétique, ruine le potentiel de la scène. Autant le film est cohérent et globalement réussi, autant certains de ses effets sont mal dosés, ou tout simplement ont donné de mauvais résultats, mais c’était trop tard pour changer… C’est relativement dommage quand on remarque que la découverte de la malédiction par la population est bien gérée (la légende prend forme), que la tragédie du prince, bien qu’inférieur en intensité à celle de Coppola (ben ouais, en 10 minutes, il te faisait une fresque gothique esthétique et intense), tente plusieurs choses. Parfois trop vite (le revirement des collègues vampires est intéressant, mais asséné trop abruptement), mais avec honnêteté. Même l’épilogue, transposé dans notre époque (arg !!!), a ce souffle d’honnêteté, qui reste à sa place en gentil hommage. Oui, Luke Evans, bien que limité dans l’expression de ses sentiments, a l’étoffe de Dracula, il en a aussi le physique, et il met à profit les entraînements qu’il a reçu sur le Hobbit. Ca fait en tout cas du bien d’être surpris. Pas non plus admiratif, mais satisfait. Le 6/10 n’était pas loin…
2014
de Gary Shore
avec Luke Evans, Sarah Gadon













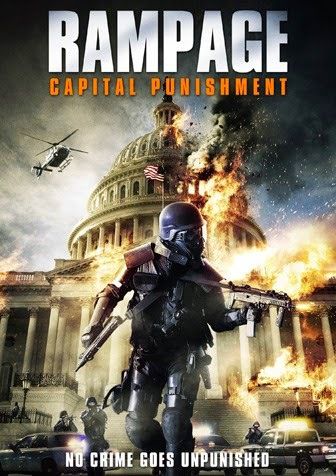






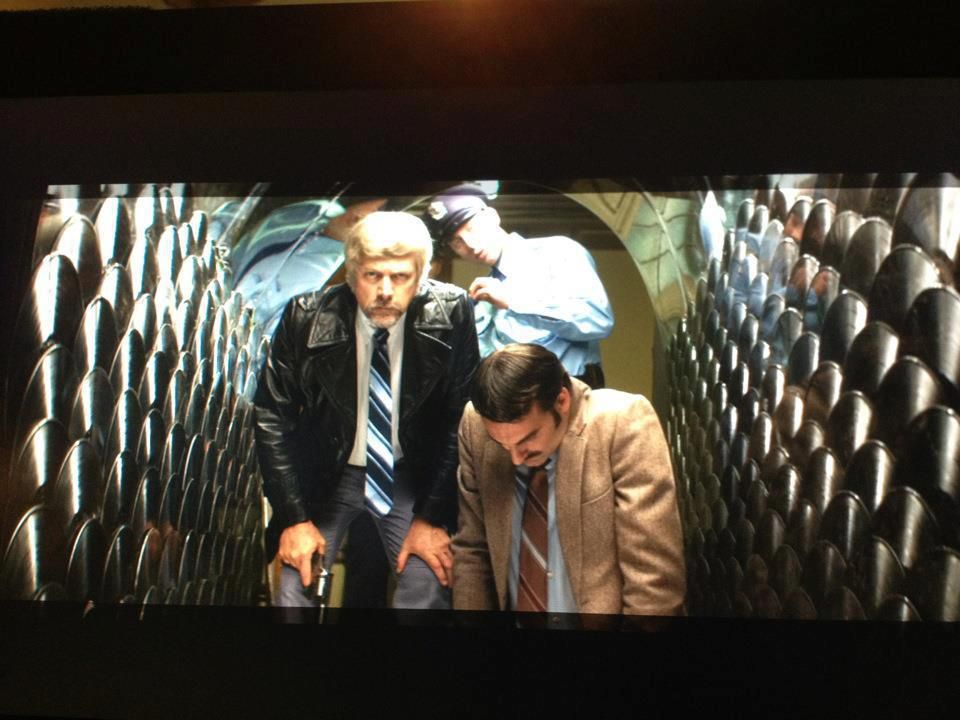



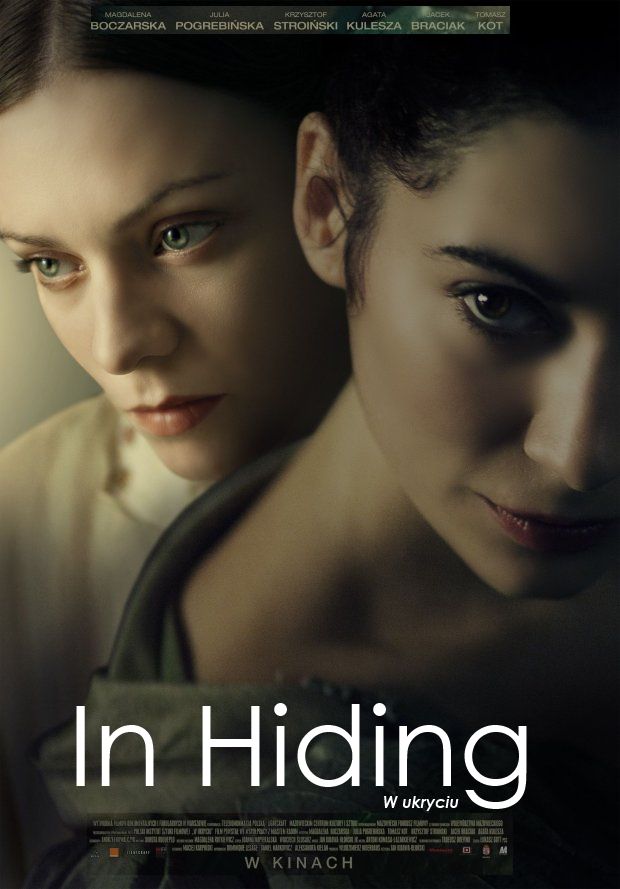







/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)