
Avec Joe Dante, on sait qu’on ne s’ennuiera jamais. Compère turbulent de Steven Spielberg toujours porté sur l’horreur, il développe beaucoup d’énergie pour façonner un cinéma en dehors des normes, toujours tourné vers son public. Et avec Panic on Florida Beach, il tente de nous offrir la séance de cinéma la plus mémorable du cinéma bis.
L’histoire : alors que la menace d’un holocauste atomique plane sur l’Amérique des années 50, Lawrence Woolsey, énergumène réalisateur de films d’horreur, vient présenter son dernier film, qu’il promet comme le plus terrifiant de tous les temps.

Vraiment, il convient de saluer bien bas ce cri d’amour déclaré à tout un pan du cinéma bis. Dante a parfaitement compris quel était le charme de ces bandes horrorifiques ringardes des années 50 (tous ces nanars types Robomonster ou l’attaque des sangsues géantes…), et il décide de nous le ressortir aujourd’hui, mais en puissance 10. Ainsi, les effets volontairement nanars du film d’horreur Mant (des femmes qui passent leur temps à crier, des figurants qui courrent dans tous les sens, des maquillages partiels qui font très plastique…) sont autant d’éléments attachants qui viennent ajouter à la sympathie du film. Et si la projection tant attendue ne commencera qu’au milieu du film (le temps de développer un peu les personnages et le contexte extérieur, parfois long, mais un régal de nostalgie), elle comble toutes nos espérances. Indéniablement, Panic on Florida Beach fait partie de cette famille de films (incluant Démons ou Angoisse) qui jouent avec leur public en leur faisant faire de grands sauts dans leur siège de cinéma. Ici, si le film d’horreur est complètement nanar (chaque dialogue est parfaitement étudié pour tourner en dérision la soit disant tension dramatique du film), le fait que la salle soit entièrement truquée rajoute beaucoup au jubilatoire de l’entreprise, et le dernier acte n’hésite carrément pas à continuer le film dans la salle de cinéma, où le monstre (enfin, un figurant déguisé) continue le spectacle en live. Un vrai tour de force qui contribue grandement à développer l’atmosphère de spectacle qui règne dans la pièce et qui satisfait largement notre enthousiasme. Le potentiel nostalgique du film, énorme, n’a absolument pas vieilli aujourd’hui, et si il s’adresse maintenant essentiellement aux cinéphiles endurcis qui ont pu voir quelques nanars horrorifiques des années 50, il n’a en rien perdu de sa superbe. John Goodman y tient peut être là un de ses rôles les plus attachants, en réalisateur mystérieux se la jouant Hitchcock dans la présentation de ses films alors qu’il s’agit de nanars généreux en effets spéciaux de latex (c’est d’ailleurs un bon point du film Mant, les cinéphiles se rappellant avec douleur des longues scènes de dialogues qui plombent généralement ce genre de production). Ici, tout est concentré pour avancer sans cesse en développant les clichés des années 50, avec une prédilection pour les personnages d’enfants/adolescents qui désobéissent à leurs parents pour aller voir en catimini le fameux Mant si controversé par les associations de parents pour la Moralité. Bref, Panic on Florida Beach est un film bis comme on n’en fait plus, pratiquement impossible à trouver en français alors qu’il s’agit d’une récréation nostalgique des plus recommandables. Un bonheur !
4,5/6
1993
de Joe Dante
avec John Goodman, Cathy Moriarty







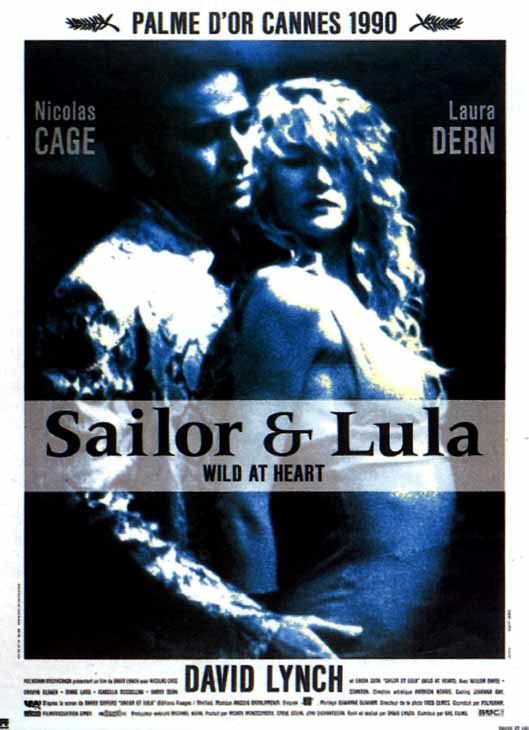























/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)