Attention, cet article contient des photographies explicites et ne devrait pas être vu par des mineurs sans l'accord de leur tuteur légal. Pour les agrandir, cliquez dessus.
Maria Beatty est une réalisatrice qui a œuvré toute sa vie dans le cinéma lesbien à tendance underground. Dans le genre masturbation cérébrale, on pensait que ça serait difficile de faire pire. Pourtant, au fur et à mesure de ses différents travaux, la réalisatrice fait toujours preuve d’une recherche esthétique explorant différents terrains (noir et blanc, esthétique punk agressive, variations d’ambiances (allant du bondage chinois aux roads movie en mode cow boy…)), et surtout en s’assumant pleinement comme des pornos lesbiens réalisés pour le plaisir esthétique (en plus, évidemment, de mettre en scène le plaisir/désir des « actrices » en action). Le résultat est assez... variable, puisque chaque moyen métrage porno (dont les durées varient entre 20 et 50 minutes) explore un nouveau terrain esthétique.
Si on doit faire un tri dans les moyens métrages de Maria Beatty, on peut déjà séparer le noir et blanc de la couleur. Le noir et blanc a beaucoup inspiré la réalisatrice, car elle adore mettre en scène son fétichisme dans des contextes rétro (the elegant spanking ou Ecstasy in Berlin). Car si ces films sont traités ici, c’est surtout pour l’angle esthétique (et pas pour la pornographie, allons allons ! Quel homme succomberait au cliché des lesbiennes ?). C’est donc avec un grand soin de l’ambiance et du cadre qu’elle a réalisé chacun de ses travaux, qui partent tous dans des directions artistiques imprévisibles. Avec toutefois un goût prononcé pour le cinéma allemand. Mon avis personnel est que le noir et blanc a donné les meilleurs films de Beatty, dont le meilleur (et le plus connu) se révèle être The black glove. Intemporel, surréaliste et d’un fétichisme extrêmement travaillé (le contraste du N&B poussé au maximum) en font un véritable OFNI, un objet graphique ultra sensoriel pas toujours de très bon goût (le gode en métal, arhem…, la bougie phallique et la séquence cire), mais d’une pureté graphique qui fait immédiatement mouche. Let the punishement fit the child (littéralement : « laissez l’enfant choisir sa punition », totalement sadique et d’un raffinement certain) et Ecstasy in Berlin (un peu trop prononcé sur le léchage de botte en cuir, mais habité par une splendide vision dans les dernières minutes) suivent le classement question qualité graphique, et. Un dernier travail en N&B, Ladies of the night, tente de partir dans le fantastique vampirique, c’est hélas un échec, la timidité de son esthétique et de ses visions le faisant paraître bien fade au regard de ses prédécesseurs.
Dans la couleur, c’est là que Maria Beatty a fait le plus preuve d’originalité, en cherchant vraiment dans tous les styles. Hélas, c’est dans cette catégorie que les résultats sont les plus aléatoires, et en fonction des goûts de chacun, beaucoup seront rejetés. Histoire de clarifier mon angle de jugement, je m’aligne sur The black glove, à savoir un fétichisme exacerbé, une esthétique évidente (un peu expérimentale), une ambiance forte et une sexualité tolérable (c’est purement subjectif, je justifierai ce critère par « une intensité sexuelle adaptée à l’esthétique et au contexte, qui n’agresse pas l’œil au détriment de la recherche esthétique). C’est sans doute un peu vain de ma part de vouloir « borner » la sexualité d’un porno lesbien, mais comme je m’y confronte sous un angle esthétique… Histoire d’illustrer mon propos, on commence avec mon préféré de la catégorie « couleur » : Lust (le bien nommé). C’est une esthétique jaune aux couleurs ultra saturées, dont le caractère fauché fait davantage écho aux VHS des vidéos clubs plutôt qu’à la froideur esthétique de ses précédents travaux. Néanmoins, la chaleur qui se dégage de la pellicule est bien là. Question saphisme, ça y va avec quelques fessées, sur fond de musique affreuse qui se révèle être le principal handicap de cet essai. Silken sleeves arrive juste après (un de ses travaux les plus connus également), rendant hommage aux productions japonaises accros au bondage. Même si je préfère La maison des sévices de Takashi Miike, les couleurs chatoyantes et le modeste fétichisme des cordes donne un certain intérêt à ce travail (je précise que ces deux films sont muets). Enfin, The seven deadly sins (qui pour peu qu’on ait de l’humour, peut recevoir une gentille moyenne (quelques beaux plans, et le ridicule nanar de la soubrette en tablier d’appartement se faisant dominer par une maîtresse de maison très attachée à sa cravache…)). Pour le reste, c’est là que mon dernier critère en dévalue beaucoup. Certains, comme Sex Mannequin (très belle intro) ou Strap on Motel (beau rendu des éclairages des néons) partent d’une bonne idée, mais s’abandonnent à une sexualité bien trop frontale et directe pour prétendre à une recherche artistique. Bon, on sait à quoi on s’expose en regardant un porno lesbien, mais l’étiquette de la maîtrise artistique ne peut guère être avancée ici (oui, la photographie est jolie, mais les détails anatomiques m’intéressent moins que l’ambiance autour). D’autre enfin, comme The Boiler room ou Skateboard kink freak, sont de simples porno lesbien, très underground dans leur approche (complètement SM pour le premier, punk chez le second), mais focalisés sur le sexe et non sur l’ambiance. Au rayon des fantasmes, je préfère laisser chacun chercher ce qui l’intéresse, et dans mon cas, la recherche d’esthétique exotique s’arrête à un certain stade de pudeur. Un petit débroussaillement sur les terres du fétichisme raffiné et du porno lesbien, c’est quand même autrement plus stimulant que la prochaine adaptation de 50 nuances de grey…




/image%2F1146095%2F20140716%2Fob_edb044_vlcsnap-494722.png)
/image%2F1146095%2F20140716%2Fob_882e70_vlcsnap-498038.png)
/image%2F1146095%2F20140716%2Fob_c031e0_vlcsnap-508007.png)
/image%2F1146095%2F20140716%2Fob_b46ac5_vlcsnap-508314.png)
/image%2F1146095%2F20140716%2Fob_9fa71f_vlcsnap-509401.png)
/image%2F1146095%2F20140716%2Fob_626a26_vlcsnap-500004.png)
/image%2F1146095%2F20140716%2Fob_61b119_vlcsnap-505009.png)
/image%2F1146095%2F20140716%2Fob_92a3d0_vlcsnap-503815.png)







/image%2F1146095%2F20140804%2Fob_d18086_1466317-403835023083732-1571914119-n.jpg)
/image%2F1146095%2F20140804%2Fob_31f4d9_letrange-couleur-des-larmes-de-ton-co.jpg)



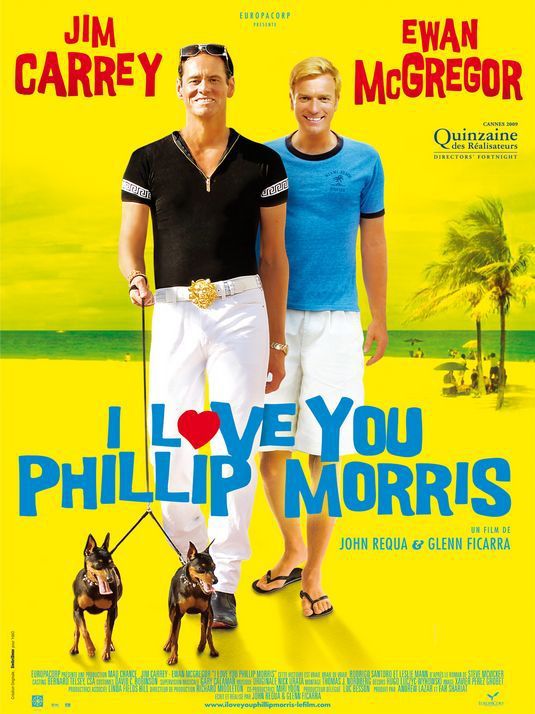


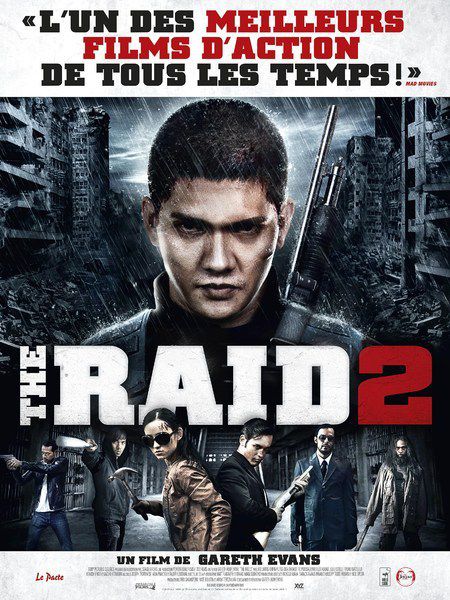














/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)