It follows est un petit film d'horreur qui bénéficie d'un buzz assez exagéré, bien qu'on comprenne le contexte de sa sacralisation (petit film d'horreur indépendant, joli portrait d'adolescent...). C'est donc sur le terrain de la surprise que nous sommes sensés nous être aventuré. Pour un résultat qui laisse finalement plus mitigé qu'autre chose.
L'histoire : une jeune fille sort avec un gars craquant, qui lui explique une fois l'acte consommé qu'une créature va la poursuivre jusqu'à ce qu'elle la rejoigne pour lui régler son compte.
Slasher étudiant qui donne immédiatement dans le fantastique à l'ancienne, It follows aime donner dans l'ambiance, et cela se ressent. Que ce soit par ses banlieues automnales empruntées aux Griffes de la nuit (vous avez noté le numéro de la maison dans l'introduction ?) ou ses programmes télé vintage des années 50, le film brise la cohérence temporelle. Pourquoi ? Pour rien. Ca marche cependant. On passe ensuite à la présentation de notre étudiante, appuyée par une jolie photographie. Et la mécanique s'enclenche. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on note souvent des remarques qui réfutent le côté horrifique du film en disant qu'il ne fonctionne pas. C'est faux. Les premières apparitions de la créature sont un modèle d'efficacité. En particulier la scène de home invasion, particulièrement réussie et stressante. Le concept est bien exploité (même si il n'exploite pas tout). La séquence finale dans la piscine municipale est elle aussi intéressante, mais hélas, l'impact en est amoindri par une faute de mise en scène (l'identité physique prise par la créature, dévoilée seulement après). Néanmoins, la caractérisation des personnages ne faiblit jamais, ils méritent tous notre intérêt, et ce sont eux qui amorcent le prétendu discours sur la sexualité. En effet, pour faire le buzz et dire qu'on parle des étudiants, faut parler de sexe. On loue Larry Clark pour cela alors qu'il est un exemple même du genre underground fermé au grand public. Et ici, qu'est-ce qu'on dit sur le sexe ? Ben... on sait pas trop. La créature est liée à l'idée, mais on ne sait pas pourquoi, les relations entre les protagonistes sont bien exposées sans qu'elles mènent à l'illustration précise d'une idée (certains ont un charisme sexuel qui leur ouvre des cuisses, les autres prennent leur ticket d'attente...). Au final, It follows reste constamment dans le flou. Et c'est ce manque de parti pris qui finit par lui nuire, car à la longue, il souligne combien son contenu est une beaudruche. Avec des qualités formelles évidentes, mais qui ne mène à rien. On peut néanmoins ne mener à rien et être divertissant, mais alors, c'est le buzz et ses prétentions qui étaient malvenues (ce n'est pas la première fois qu'on surestime le genre. Et donc, à sa tiédeur thématique, on pourra sans doute lui préférer le DTV Inside, film fort peu connu et pourtant étonnamment proche en termes de mécanique de It Follows (un sort qui forçait une personne à se suicider et contaminait le premier témoin de la scène, en prenant la forme de sa propre apparence physique), qui assurait son fond avec des cathos intégristes et une lignée de sorcière jouant le rôle de mouton noir... Cliché, mais sans zone d'ombre, et efficace émotionnellement. Ici, le sentiment de superficialité culmine, réhaussé par un épilogue absolument mauvais, qui bâcle totalement sans donner le petit frisson qui s'imposait. Une excellente bande originale ne compensera jamais vraiment un script faiblard, aussi, il y a fort à parier que si suite il y a, le pompage d'Hidden s'imposera de lui-même...
2014
de David Robert Mitchell
avec Maika Monroe, Keir Gilchrist






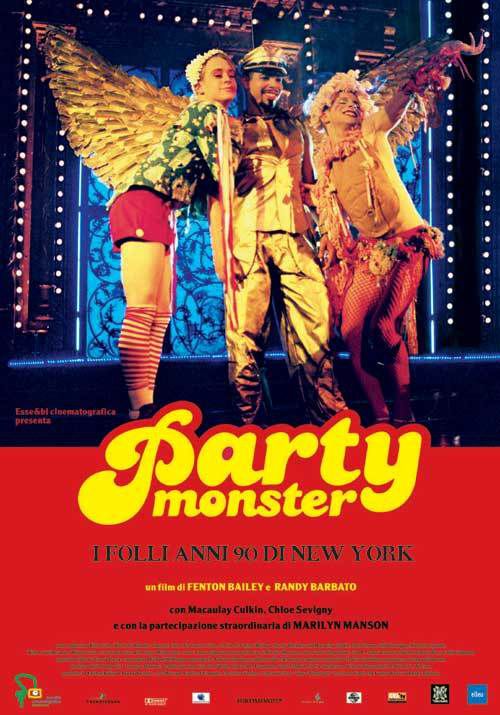









/image%2F1146095%2F20150127%2Fob_6e7c7c_affiche.jpg)
/image%2F1146095%2F20150127%2Fob_a8c6c9_the-experiment-201x3001.jpg)






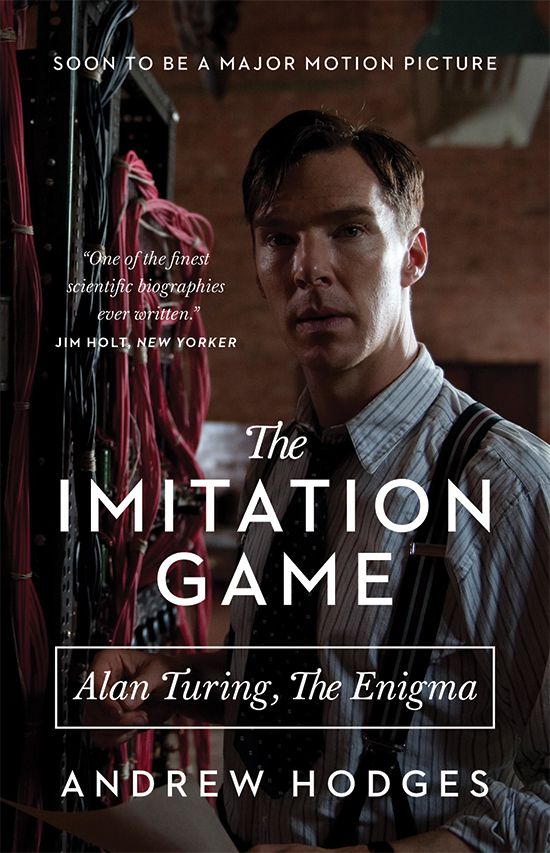



/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)